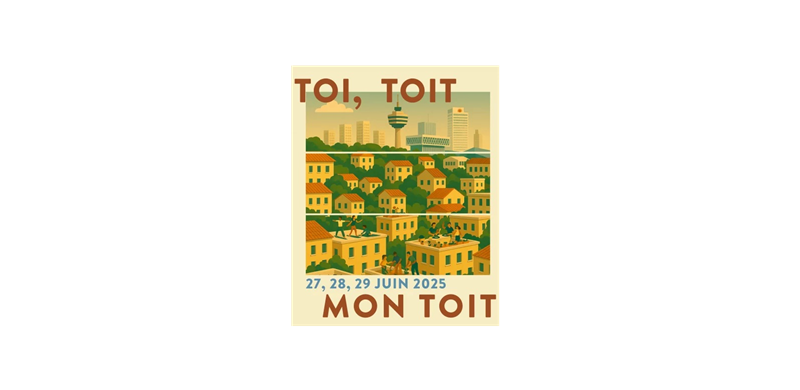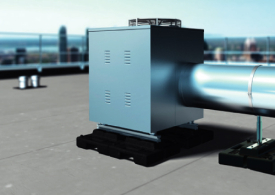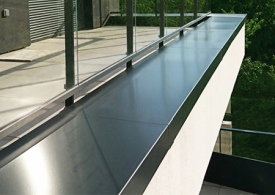Le rooftop de la piscine Molitor à Paris
Le rooftop de la piscine Molitor à Paris
Ne l’appelez plus « toit-terrasse ». Aujourd’hui, la tendance est au rooftop. Le concept est né aux Etats-Unis dans les années 1880 avec la construction du premier « roof garden theater ». Baptisé le Casino Theater, ce théâtre en plein air est alors destiné à attirer les spectateurs qui fuient les salles surchauffées des music halls de Broadwa...
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte