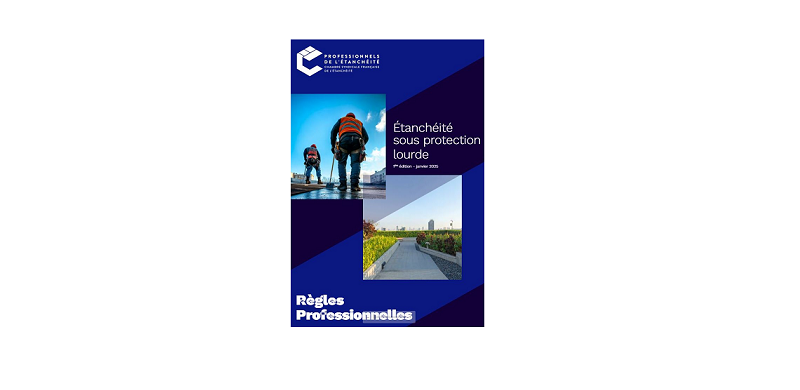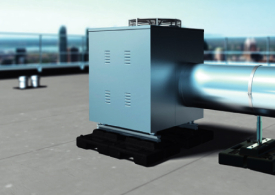(c) Soprema
(c) Soprema La révision du NF DTU 43.3 devrait imposer la pose d’un pare-vapeur pour le traitement de l’étanchéité à l’air en fonction de la typologie de l’ouvrage.
Après des mois de discussions et l’intégration d’un premier amendement dans le NF DTU 43.3, le traitement de la perméabilité à l’air des toitures acier par le recours au pare-vapeur semble désormais faire consensus. Prochaine étape : la révision complète du référentiel pour définir les conditions de son utilisation.
L’évolution de la réglementation thermique et des mentalités des maîtres d’ouvrage pousse au durcissement généralisé des exigences de performance énergétique des bâtiments. L’enveloppe doit, de plus en plus, afficher des niveaux importants en matière d’isolation mais aussi d’étanchéité à l’air. Si ces contraintes sont connues et maî...
Continuez votre lecture
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte