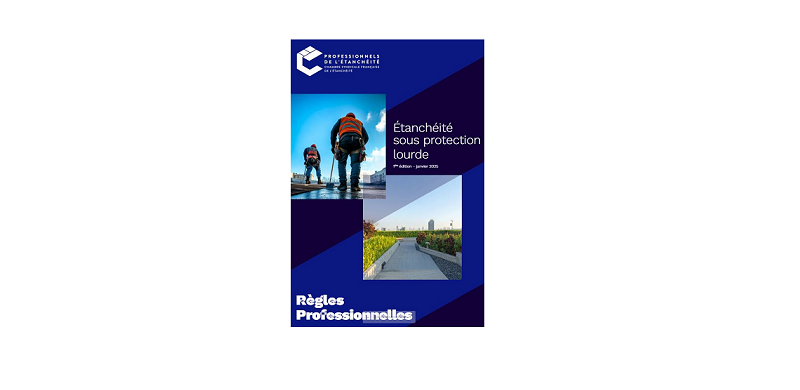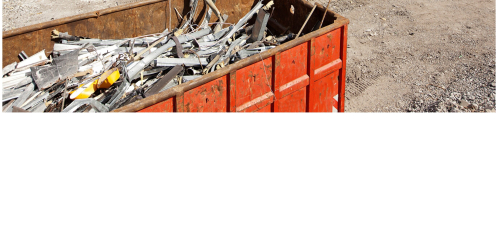(c) Soprema
(c) Soprema La CSFE met à disposition 4 FDES collectives sur différents produits d’étanchéité.
Depuis 1973 et leur première mouture, les réglementations successives applicables aux constructions neuves se concentraient sur leurs performances thermiques. Aujourd’hui, ces dernières ne suffisent plus pour faire face aux enjeux climatiques et respecter les engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre (voir encadré). Avec p...
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte