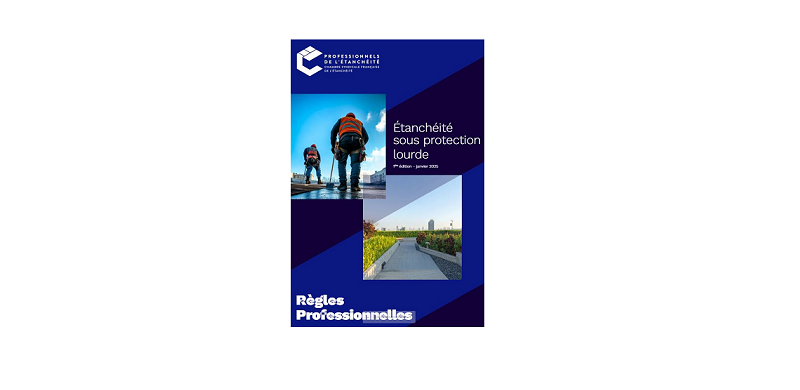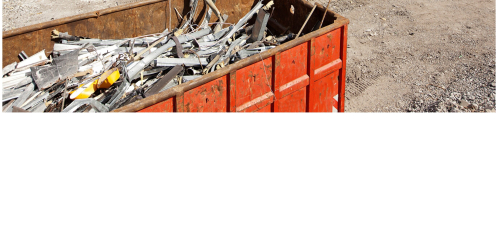La RE2020 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier et avec elle le durcissement des exigences du Bbio et les nouveaux indicateurs du degré-heure (DH) et de l’impact carbone (Ic). Moins connu et moins maîtrisé, ce dernier notamment pose questions. Voici quelques éléments de réponses avec l’analyse de la part des procédés d’étanchéité dans le bilan global d’un bâtiment neuf.
« La toiture représente entre 3 et 5 % de l’Impact carbone d’un bâtiment collectif R+4 » Entretien avec David Lebannier responsable de l’activité conseil du pôle construction pour Pouget Consultants. Quels sont les impacts des toitures-terrasses sur les nouveaux indicateurs Bbio (besoins bioclimatiques) et DH (confort d’été) ? Pour lâ
Continuez votre lecture
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte