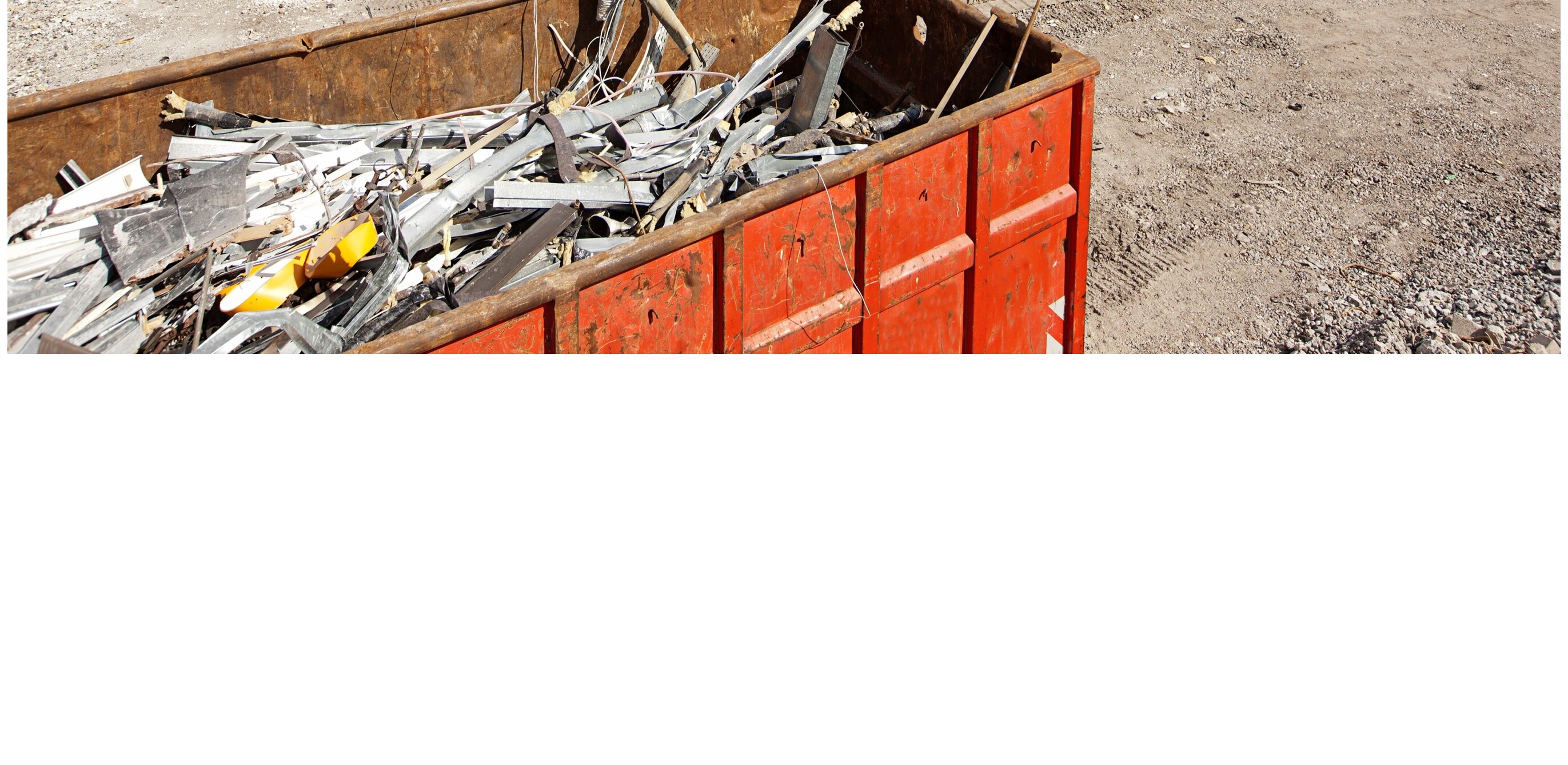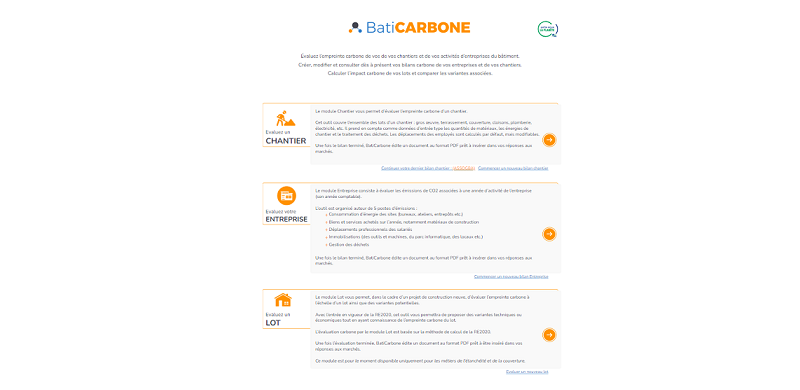Pour lutter contre les inondations,
les toits-terrasses constituent des solutions efficaces en matière de rétention d'eau,
sous réserve de mise en œuvre d'un procédé adapté.
Pour lutter contre les inondations,
les toits-terrasses constituent des solutions efficaces en matière de rétention d'eau,
sous réserve de mise en œuvre d'un procédé adapté.
Au 20e siècle, le thermomètre est déjà monté d'environ 0,6 °C dans le monde et de 1 °C en France européenne par rapport à 1850. Le phénomène s'accélère depuis et les prévisions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) considèrent que les températures moyennes vont augmenter de 1,5 °C à 6 °C d'ici la fin du sièc...
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte