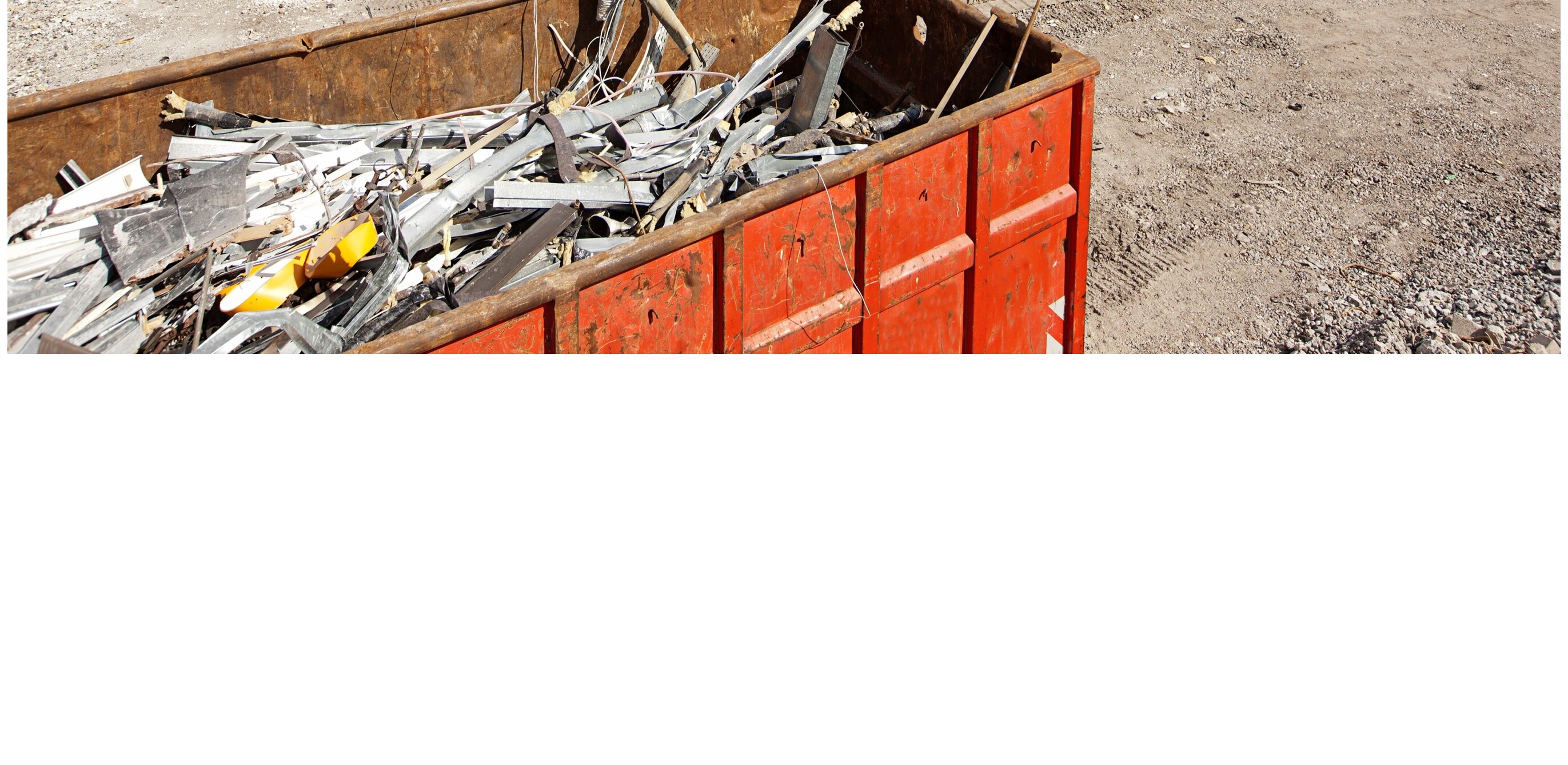J.F. Bohler / studiopygmalion
J.F. Bohler / studiopygmalion La végétalisation permet à la fois de retenir l'eau mais aussi, grâce aux plantes, de l'évapotranspirer dans l'atmosphère.
Les solutions de toiture-terrasse les plus abouties développées par les fabricants combinent végétalisation et systèmes de rétention. L’eau stockée nourrit les plantes qui l’évapotranspirent. Résultat : les volumes d’eau renvoyés au réseau sont considérablement limités, l’arrosage peut être réduit et l’atmosphère et le bâtiment support sont rafraîchis.
En matière d’eaux pluviales, la gestion dite « à la parcelle » est aujourd’hui une stratégie de plus en plus communément adoptée par les villes et communautés de communes. Un virage à 180° par rapport à la politique du tout réseau qui a commandé jusqu’au début des années 2000. Instauré à la fin du XIXe siècle, le fameux tout-à-l’égo...
Continuez votre lecture
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte