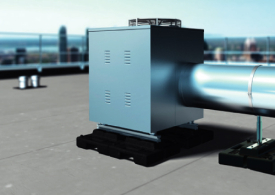(c) Interval photo / Architecte : JP Meignan
(c) Interval photo / Architecte : JP Meignan La suppression progressive de la notion d'intégration au bâti pour bénéficier de bonus sur les tarifs d'achat bénéficie aux procédés photovoltaïques surimposés.
La promulgation en 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte a renforcé les ambitions environnementales françaises. Les consommations d'énergie devront diminuer de 38 % d'ici à 2020 et de 50 % d'ici à 2050. En 2030, il faudra également avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à leur niveau de 1990....
Pour poursuivre votre lecture et accéder aux contenus en illimité, connectez-vous ou créez votre compte gratuitement.
Vous n’avez pas encore de compte ? Je crée un compte